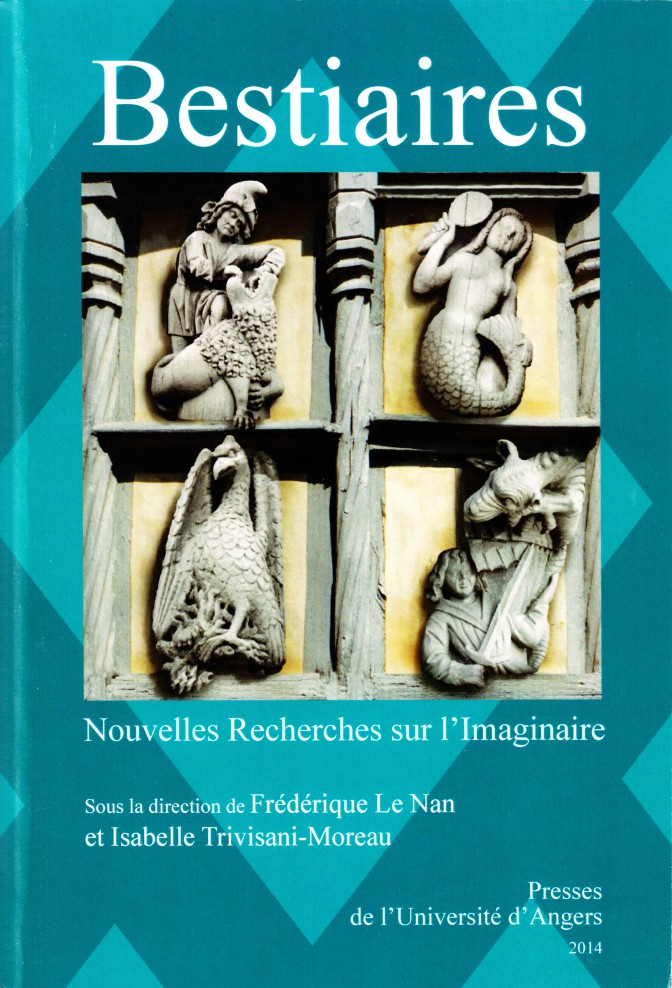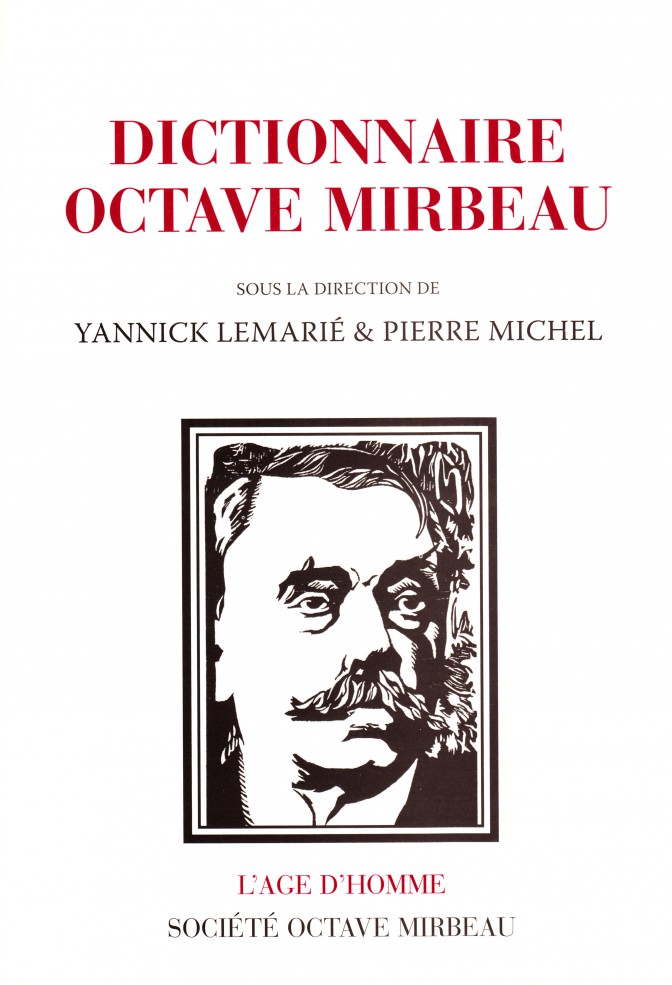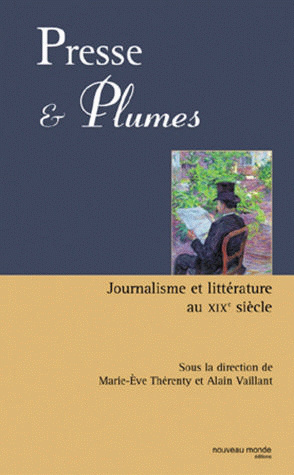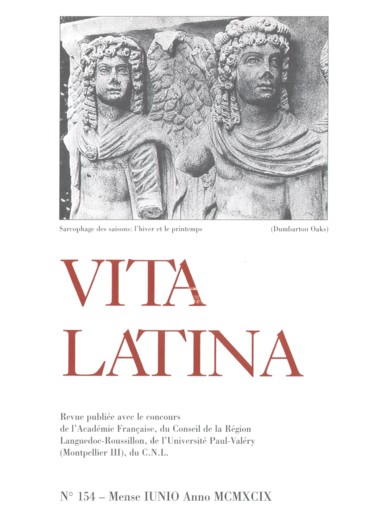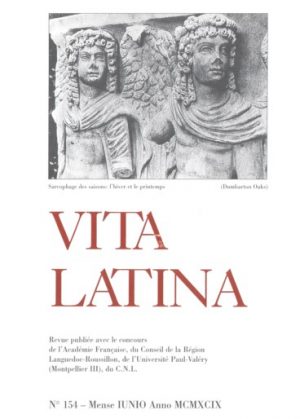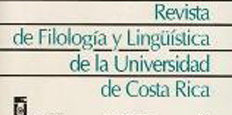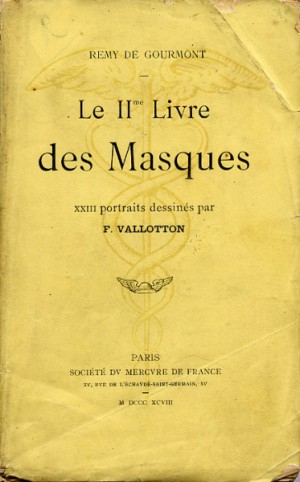Entre les différents écrits de M. Schwob, conte, histoire, analyse psychologique, je ne fais d’abord aucune distinction, afin de me conformer à sa méthode, à laquelle je crois. Du réel au possible, il y a la distance d’un nom ; le possible, qui n’a pas de nom, pourrait en avoir un et le réel souvent s’est aboli sous l’anonyme. Parmi les bustes d’inconnus qui sont au Louvre (et partout) taillés en marbre, il y a peut-être celui qui nous manque, de Lucrèce ou de Clodia, et, parce qu’il est innommé nous ne sentons, en le regardant, aucun de ces frissons qui nous troublent devant les figures qui ont vécu. Révérencieux par l’héritage d’un enseignement héroïque, nous voulons que les masques un instant posés sur nos yeux aient abrité, ruches privilégiées, un grand mouvement de pensées, une noble rumeur d’abeilles ; mais nous oublions que ni les idées des hommes, ni leurs actes ne sont écrits dans leur apparence charnelle, et que d’ailleurs, vue et reproduite par un artiste, cette apparence contient désormais le génie de l’artiste et non le génie du personnage. Devant celui qui est né pour interpréter des figures, la face d’un tisserand et la face de Gœthe, l’arbre obscur du bois inconnu et le figuier de saint Vincent de Paul ont absolument la même valeur : celle d’une différence.
Le monde est une forêt de différences ; connaître le monde, c’est savoir qu’il n’y a pas d’identités formelles, principe évident et qui se réalise parfaitement dans l’homme puisque la conscience d’être n’est que la conscience d’être différent. Il n’y a donc pas de science de l’homme ; mais il y a un art de l’homme. M. Schwob a dit là-dessus des choses que je veux déclarer définitives, ceci par exemple : « L’art est à l’opposé des idées générales, ne décrit que l’individuel, ne désire que l’unique. Il ne classe pas ; il déclasse. » Paroles singulièrement lumineuses et qui ont encore un autre mérite : celui de fixer nettement par quelques syllabes la tendance actuelle des meilleurs esprits. Que j’aurais voulu, lors de la guerre en Grèce, qu’un voyageur m’eût parlé de la marchande d’herbes qui promène sa corbeille le long de la rue d’Eole, la matin ! Que pensait-elle ? Comment sa vie se mouvait, particulière, « unique », au milieu des rumeurs, voilà ce que j’aurais voulu savoir. Elle, ou un cordonnier, ou un colonel, ou un portefaix. J’attends cela aussi des explorateurs, mais aucun ne semble avoir jamais compris l’intérêt des vies individuelles coudoyées le long des fleuves : l’homme vit au milieu de décors qu’il n’a même pas la curiosité de frapper du doigt pour les savoir en bois, en toile ou en papier.
Cet art inconnu de différencier les existences est pratiqué par M. Schwob avec une sagacité vraiment aiguë. Sans jamais user du procédé (légitime aussi) de la déformation, il particularise très facilement un personnage d’allures même illusoires ; pour cela il lui suffit de choisir dans une série de faits illogiques ceux dont le groupement peut déterminer un caractère extérieur qui se superpose, sans le cacher, au caractère intérieur d’un homme. C’est la vie individuelle créée ou recréée par l’anecdote. Ainsi, que Lalande mangeât des araignées, ou qu’Aristote collectionnât toutes sortes de vases de terre, cela ne caractérise ni un grand astronome ni un grand philosophe, mais il faut compter ces traits parmi ceux qui serviront à différencier Lalande de lui-même et Aristote de lui-même. Faute de connaître de tels détails, le vulgaire s’imagine les hommes célèbres en la perpétuelle attitude d’une figure de cire ; et si on les lui révèle, il s’indigne, faute de les comprendre, contre ce qui est un des signes les plus clairs d’une vie individuelle. Les hommes veulent que les hommes qu’on leur raconte soient logiques, sans s’apercevoir que la logique est la négation même d’une existence particulière.
Je tente d’expliquer une méthode ; c’est plus difficile que de dire son impression sur le résultat obtenu. Le résultat, en plusieurs volumes de contes et particulièrement dans les Vies imaginaires, est qu’une centaine d’êtres sont nés, remuent, parlent, suivent les routes de terre ou de mer avec une merveilleuse certitude vitale. Si l’ironie de M. Schwob s’était un peu inclinée vers le genre de mystification (où excella Edgar Poe) que les Américains appellent hoaxe, que de lecteurs même savants il aurait pu duper avec cette vie de Cratès, cynique, où pas un mot ne détruit la sérénité d’une biographie authentique ! Pour arriver à donner une telle impression, il faut une grande sûreté d’érudition, une pénétrante imagination visuelle, un style pur et flexible, un tact fin, une légèreté de main et une délicatesse extrêmes, enfin le don de l’ironie : avec toutes les vertus bien à leur aise dans un génie particulier, il était très facile d’écrire les Vies imaginaires.
Le génie particulier de M. Schwob est une sorte de simplicité effroyablement complexe ; c’est-à-dire que par l’arrangement et l’harmonie d’une infinité de détails justes et précis, ses contes offrent la sensation d’un détail unique ; il y a dans la corbeille à fleurs une pivoine que seule on voit parmi les autres abolies, mais si les autres fleurs n’étaient pas groupées autour d’elle, on ne verrait pas la pivoine. Comme Paolo Uccello dont il a analysé le génie géométrique, il envoie ses lignes vers la périphérie, puis les ramène au centre ; la figure de Frate Dolcino, hérétique, semble dessinée d’une seule spirale comme le Christ de Claude Mellan, mais le bout du trait est enfin relié à son point de départ par une courbe brusque.
L’ironie de ces contes ou de ces vies n’est que rarement accentuée comme au début de MM. Burke et Hare assassins : « M. William Burke s’éleva de la condition la plus basse à une renommée éternelle » ; elle est plutôt latente, répandue sur toutes les pages comme un ton discret et d’abord invisible. M. Schwob, au cours d’un récit, ne sent jamais le besoin de faire comprendre ses inventions ; il n’est aucunement explicatif : cela encore donne une impression d’ironie par le contraste naturel que nous trouvons entre un fait qui nous semble merveilleux ou abominable et la brièveté dédaigneuse d’un conte. Mais, à un très haut degré, devenue tout à fait supérieure et désintéressée, l’ironie confine à la pitié ; enfin, il se fait une métamorphose et nous ne voyons plus les lumières de la vie que comme « des petites lampes qui éclairent à peine la pluie la plus obscure ». L’ironie a dévoré sa cause, nous ne savons plus nous distinguer d’avec les misères qui nous faisaient sourire et nous aimons l’erreur humaine dont nous faisons partie : diminuée de l’intérêt que nous donnions à notre supériorité, la vie ne nous apparaît plus que comme une petite chambre d’hospice où des poupées mangent des grains de mil dans des sous d’étain : c’est le douloureux et pourtant cordial Livre de Monelle, chef-d’œuvre de tristesse et d’amour.
Il n’y a qu’un défaut dans Monelle, c’est que le premier chapitre est une préface et que les paroles de Monelle, obscures et fermes, n’ont point d’application inévitable dans l’histoire de Madge, de Bargette ou de la petite Femme de Barbe-Bleue, toutes pages, et d’autres, d’une psychologie infiniment délicate, avec ce qu’il faut de mystère pour relever un récit d’entre les anecdotes. M. Schwob a voulu faire dire à ces douces petites filles plus de choses que peut-être n’en contient leur petite tête étonnée, et même celle de Monelle : à faire alterner les explications et les figures, on gêne celui qui voudrait trouver tout seul l’explication de la figure ; il a couru le risque, parfois, de tuer ses imaginations par des raisonnements. Il faut goûter les unes et les autres, mais successivement, et ne pas trop vouloir jouir de Monelle selon les paroles de Monelle. Les préfaces dérangent les lignes d’une œuvre d’art ; celui qui regarde ou qui lit ne comprend pas selon qu’il est écrit par des taches ou des caractères ; il ne comprend pas selon le génie du poète, mais selon son propre génie. J’ai vu un livre qui à un tel sembla de pur sensualisme, incliner un autre lecteur à des vues métaphysiques et un autre à des pensées seulement tristes. Laissons à ceux que nous sollicitons le plaisir d’une collaboration ingénue.
Pourtant nous ferons toujours, et M. Schwob fera toujours des préfaces, mais des siennes, qui en valent la peine, on ordonnera des livres, à mesure, dans le goût de Spicilège, et nous ne serons pas distraits par le devoir de changer à chaque chapitre la robe de notre poupée.
Elle est d’ailleurs importante, cette préface de Monelle, pour la psychologie de M. Schwob et pour la psychologie générale d’une période ; j’y vois notées en phrases décisives et prophétiques presque toutes les notions qui sont demeurées communes aux intellectuels d’une génération : le goût d’une morale surtout esthétique, d’une vie sentie dans le résumé d’un moment, d’un infini qui se peut encercler dans l’espace de l’œuvre présente, d’une liberté insoucieuse de son but. L’humanité est pareille à un filet nerveux, c’est-à-dire discontinu, formé d’une série de petites étoiles dont les chevelures, dans un mouvement incessant, touchent les chevelures voisines, au hasard pendant le sommeil et, dans la veille, selon les volontés, dont le caprice fait les dissemblances humaines ; si l’on coupe un morceau central du nerf, les cheveux s’allongent au-dessus de la blessure, parce qu’ils sentent le besoin de toucher d’autres cheveux : de petits égoïsmes vitaux sont juxtaposés dans l’infini.
Les livres de M. Schwob engagent à réfléchir après qu’ils ont plu par l’imprévu des tons, des mots, des faces, des robes, des vies, des morts, des attitudes. C’est un écrivain des plus substantiels, de la race décimée de ceux qui ont toujours sur les lèvres quelques paroles neuves de bonne odeur.
Remy de Gourmont, « Marcel Schwob », Le IIe Livre des masques, Mercure de France, 1898.