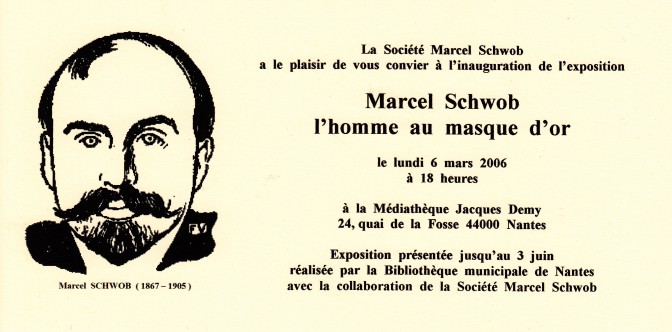Cliquer ici pour voir la vidéo

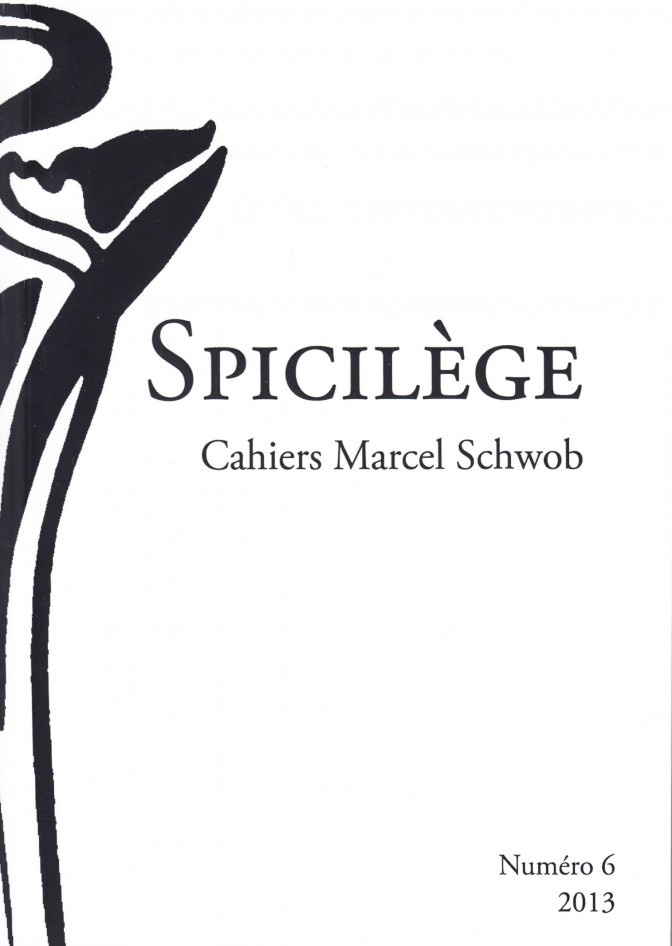
La Société Marcel Schwob a le plaisir d’annoncer la publication de la 1ère livraison de SPICILÈGE – CAHIERS MARCEL SCHWOB (2008, 74 pages), centrés sur Schwob, Villon et l’Amérique latine.
Direction : Bruno Fabre / Agnès Lhermitte
Réalisation : Julien Schuh
Tarif : 15 euros
Les commandes sont à adresser à la Société Marcel Schwob :
societe.marcel.schwob@gmail.com
Éditorial
Agnès Lhermitte
Dossier : Schwob, Villon et l’Amérique latine
Présences de Villon dans Vies imaginaires
Bruno Fabre
Marcel Schwob et l’Amérique latine
Jean-Marie Lassus
Un hommage à Marcel Schwob :
« Epitafio » de Juan José Arreola
Bruno Fabre
Schwob villoniste
Paul Valéry
Bibliographie sur Schwob et Villon
En marge du colloque de Cerisy
Diversité générique dans les récits de Cœur double
Amany Ghander
Inédit
Lettre de Maurice Schwob à Henry Brokman
Document
Marcel Schwob à Paris
Agnès Lhermitte
Glanures : notes de lecture par Bruno Fabre et Agnès Lhermitte
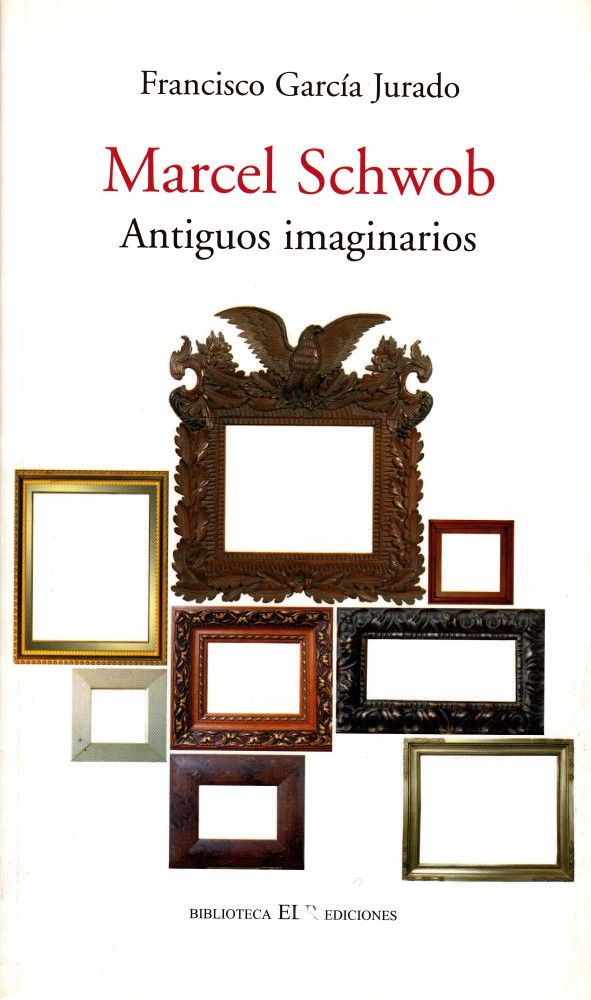
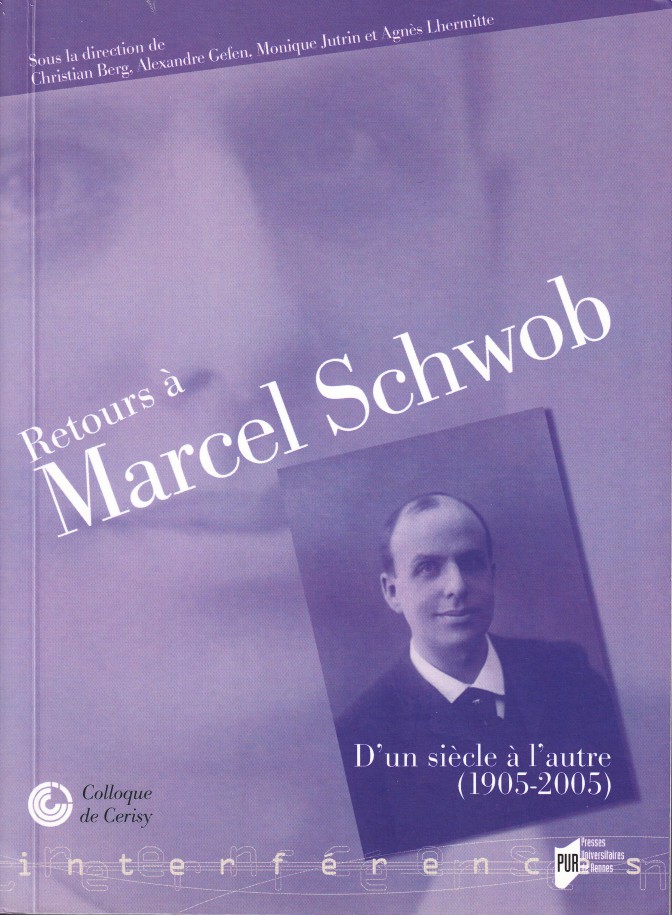
Le volume des actes du colloque de Cerisy-la-salle d’août 2005, Retours à Marcel Schwob – D’un siècle à l’autre (1905-2005), paru le 30 août 2007 et édité par les Presses Universitaires de Rennes sous la direction de Christian Berg, Alexandre Gefen, Monique Jutrin et Agnès Lhermitte, est disponible en librairie au prix de 20 euros.
Table des matières
Présentation
1. Perspectives
Alexandre Gefen :
Philosophies de Marcel Schwob
Évanghélia Stead :
Marcel Schwob, l’homme aux livres
2. Formes et créations
Hélène Védrine :
« Une taupe reste une taupe et l’absinthe une plante d’amertume » :
la traduction d’Hamlet par Marcel Schwob et Eugène Morand
Claude-Pierre Perez :
Images, imagination, imaginaire
Rita Stajano :
Cœur double : fantastique et effets de lecture
Sabrina Granger :
Le symbolisme du lien
Julien Schuh :
Marcel Schwob et Alfred Jarry : des difficultés de la synthèse
Alexia Kalantzis :
Marcel Schwob, Remy de Gourmont et l’esthétique du conte
Émilie Yaouanq :
Le dévoiement de la narration dans quelques contes de Marcel Schwob et de Henri de Régnier
3. Vies imaginaires
Bruno Fabre :
Révéler l’obscur, inventer la vie : trois Vies imaginaires
(Érostrate, Clodia, Cecco Angiolieri)
Gernot Krämer :
Le trésor déterré : Marcel Schwob et le dilemme des temps tardifs
Bernard de Meyer :
Vies imaginaires ou chroniques d’une mort annoncée
4. Amitiés et affinités
Christian Berg:
Marcel Schwob et Willem Byvanck
Frédéric Canovas :
« Écrire avec feu » : Marcel Schwob vu par Paul Léautaud
Michel Jarrety :
Valéry et Schwob : une amitié interrompue
Agnès Lhermitte :
De Marcel Schwob à Émile Gallé :
correspondances et transpositions d’art
5. Filiations et postérité
Christine Jerusalem :
Stevenson, Schwob, Renard, Echenoz : des œuvres filiales ?
Agathe Salha : Un disciple de Marcel Schwob :
Yann Gaillard, collectionneur de morts illustres
Ariane Eissen :
Deux épigones de Marcel Schwob dans la littérature italienne :
Juan Rodolfo Wilcock et Antonio Tabucchi
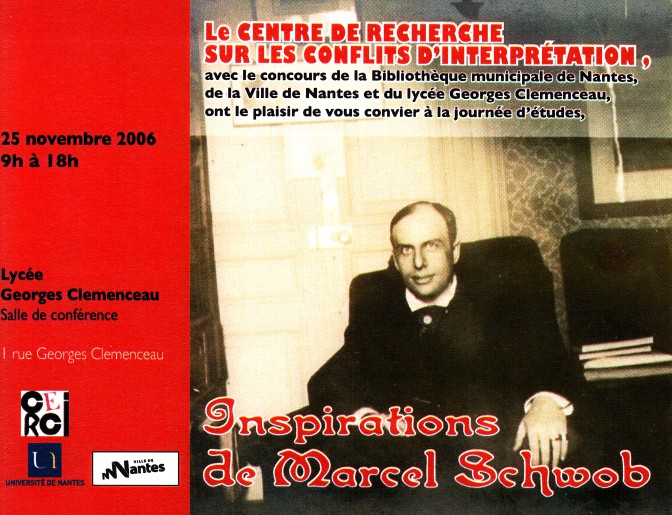
Le Centre de Recherche sur les Conflits d’Interprétation, avec le concours de la Bibliothèque municipale de Nantes, de la Ville de Nantes et du lycée Georges Clemenceau, a organisé une journée d’études « Inspirations de Marcel Schwob », qui a eu lieu à Nantes le 25 novembre 2006 dans la salle de conférence du Lycée Georges Clemenceau. Nous remercions le lycée pour l’excellence de son accueil, et les responsables du CERCI, en particulier Rodolphe Dalle, Jacques Gilbert et Jean-Marie Lassus, pour la qualité chaleureuse de cette journée.
Programme
9h15 Accueil
9h30 Jacques Gilbert (Université de Nantes)
Ouverture
10h00 Laure Cédelle (Bibliothèque municipale de Nantes)
Le fonds Schwob de la bibliothèque municipale de Nantes
10h30 Jean-Marie Lassus (Université de Nantes)
Marcel Schwob et l’Amérique latine
11h30 Bernard Gauthier (Bibliothèque nationale de France)
Construire un drame historique : les rapports entre fiction et histoire dans une œuvre théâtrale inédite de Marcel Schwob
14h00 Bruno Fabre (Université Paris IV-Sorbonne)
Présences de Villon dans Vies imaginaires de Marcel Schwob
15h00 Présentation d’une vidéo inspirée par « L’homme voilé »
16h00 Rodolphe Dalle (Université de Nantes)
Météores, mélancolie et continuité :
l’inspiration fragmentaire de Marcel Schwob
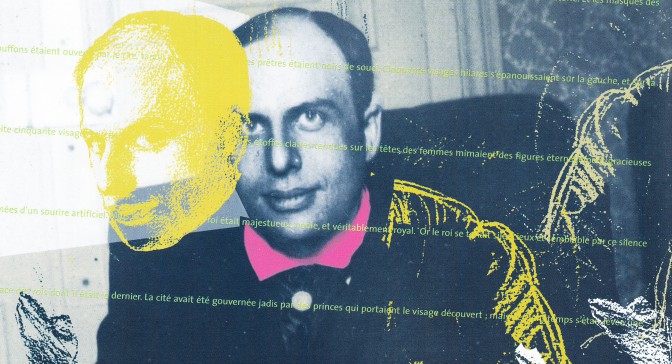
L’exposition « Marcel Schwob – L’Homme au masque d’or » a eu lieu du 6 mars au 3 juin 2006 à la Médiathèque Jacques Demy, à Nantes. Remercions la Bibliothèque et la Ville de Nantes pour leur engagement et la qualité exceptionnelle du travail accompli.
Cette exposition a été organisée par la Bibliothèque et la Ville de Nantes, en partenariat avec la Société Marcel Schwob (commissariat : Laure Cédelle-Joubert, conservatrice à la Bibliothèque municipale de Nantes ; Bernard Gauthier, conservateur à la Bibliothèque nationale de France et secrétaire de la Société Marcel Schwob).
Elle a bénéficié des recherches qui ont accompagné les rééditions récentes des textes de Marcel Schwob. Pour la première fois ont été présentés au public les manuscrits autographes conservés par la Bibliothèque municipale de Nantes, ainsi que de nombreuses éditions illustrées et une riche iconographie. Les pièces prêtées par différentes institutions (Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Bibliothèque historique de la Ville de Paris) ont complété le panorama, éclairant aussi bien le milieu familial de l’auteur (Maurice Schwob, Léon et Claude Cahun, Marguerite Moreno) que son entourage littéraire et artistique.
Parmi les pièces exposées, il faut citer le chat « dévotieux » réalisé par Émile Gallé, l’affiche de Mucha représentant Sarah Bernhardt dans le rôle d’Hamlet, le volume de la Porte des rêves illustré par Georges de Feure, une édition inconnue de Villon provenant de la Bibliothèque de Marcel Schwob, enfin le mystérieux « collier de kabbaliste » lui ayant appartenu et qui se trouvait dans l’atelier d’André Breton.
Il faut aussi mentionner la présentation de plusieurs planches du Capitaine écarlate, album-hommage sous la forme d’une vie imaginaire conçu par deux des plus grands auteurs de bandes dessinées contemporains, Emmanuel Guibert et David B., qui a reçu un accueil remarqué lors de sa publication en 2000.
Pierre Sandre signe dans le numéro 28 de la revue Histoires littéraires un compte-rendu de l’exposition elle-même.
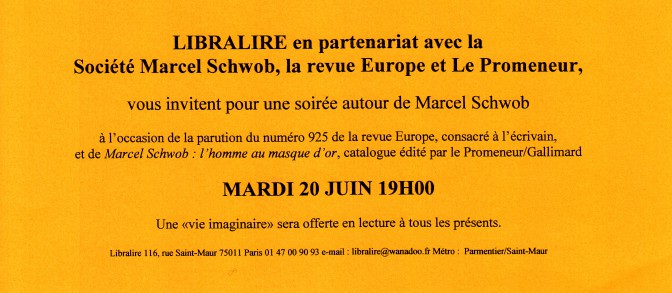
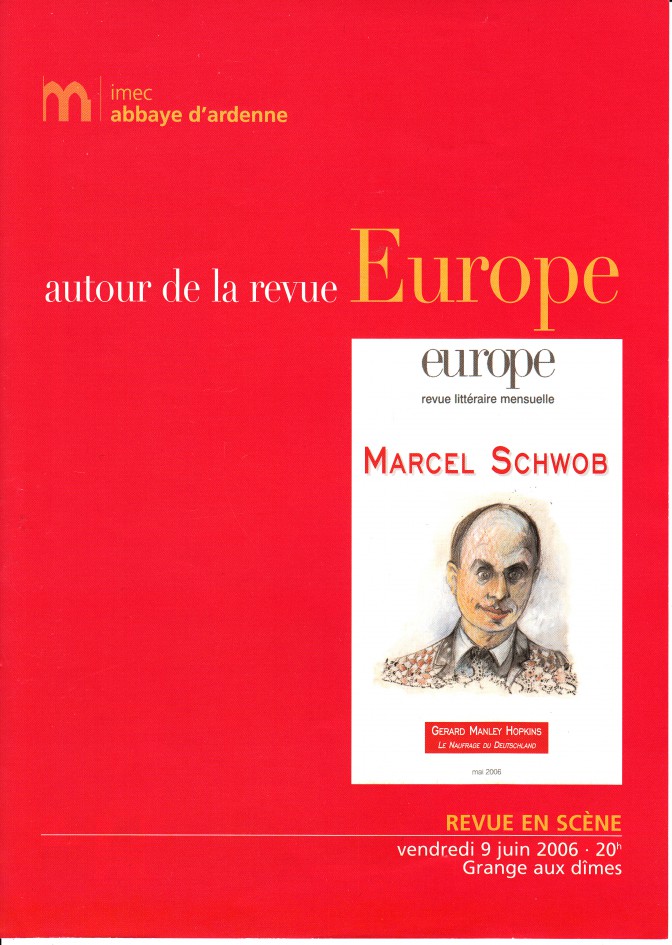
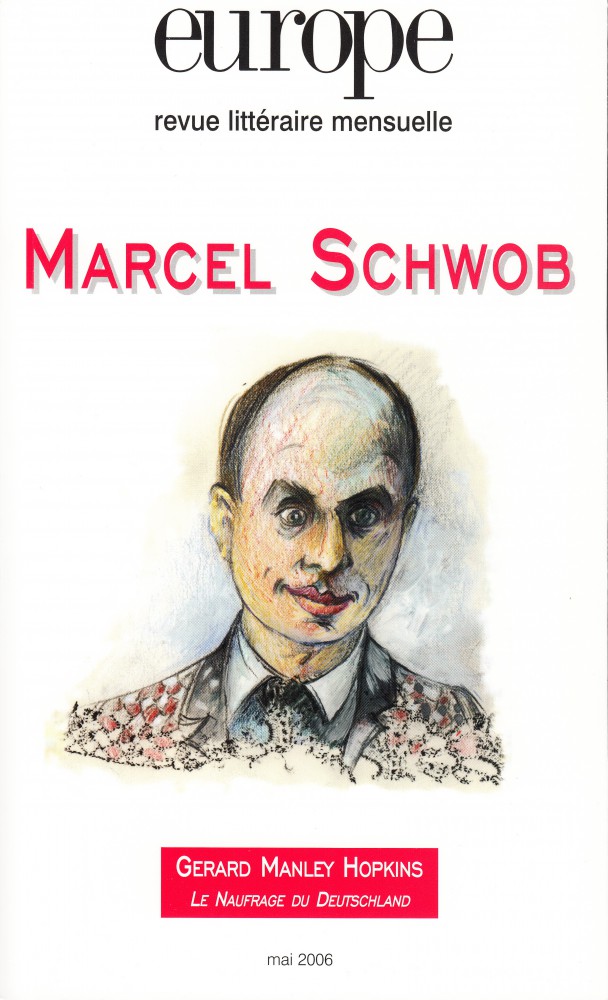
Le numéro 925 de la revue Europe, consacré à Marcel Schwob, est paru en mai 2006.
Au sommaire de ce volume riche et passionnant, des contributions d’Alexandre Gefen, Florence Delay, Fleur Jaeggy, Thomas Regnier, Patrice Allain, Marguerite Cahun, Bruno Fabre, Monique Jutrin, Agnès Lhermitte, Bernard De Meyer, Amany Ghander, Sophie Rabau, Gisèle Vanhese, Bernard Gauthier, Jean-Pierre Naugrette, Gernot Krämer, Christine Jérusalem, Jean Echenoz et… Marcel Schwob.
Cliquer ici pour la présentation et le sommaire de ce numéro sur le site d’Europe.