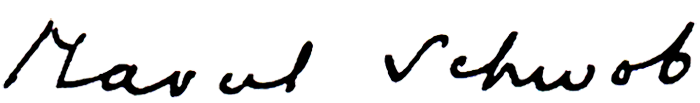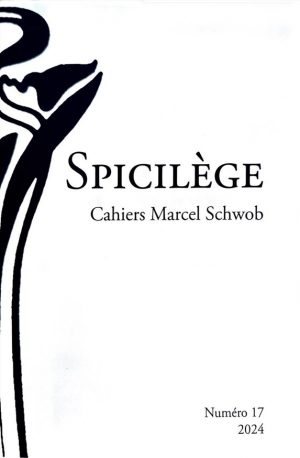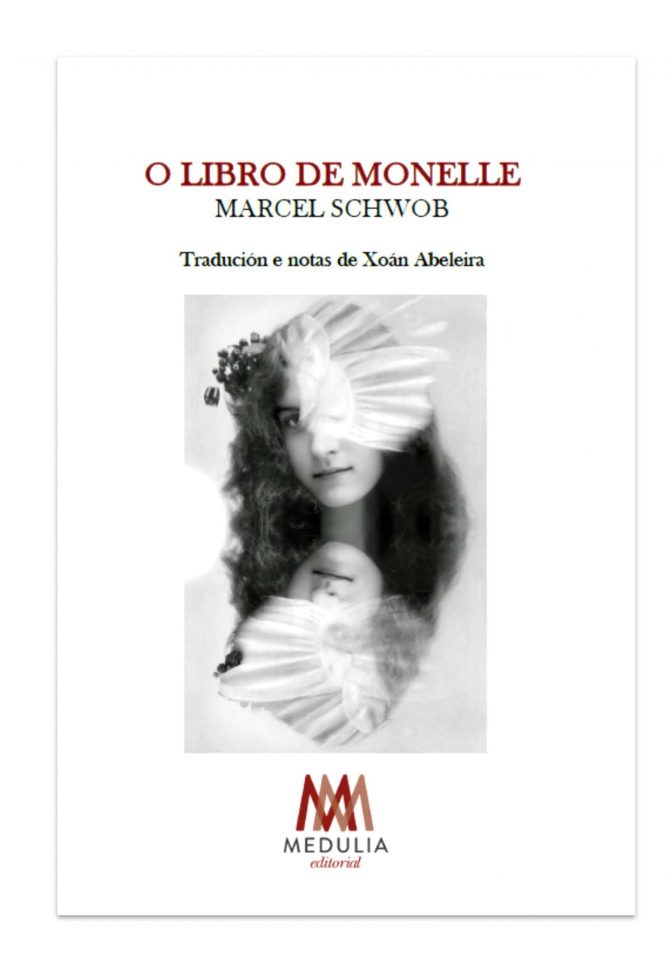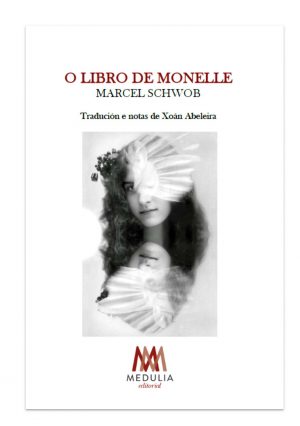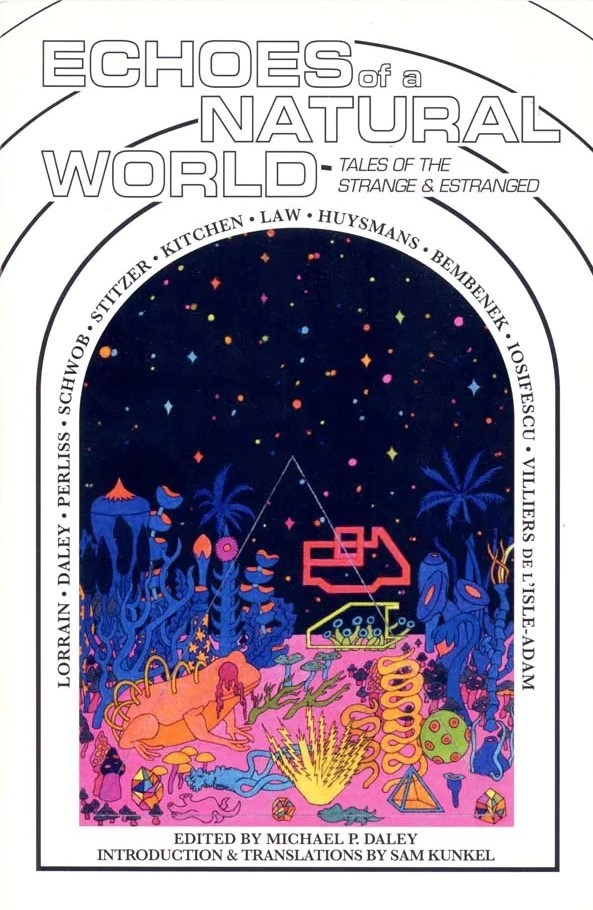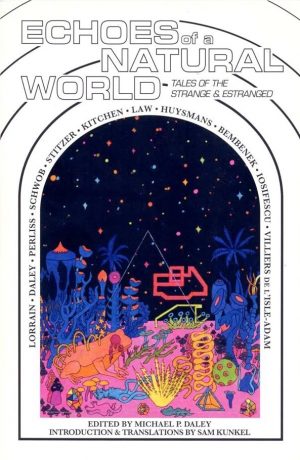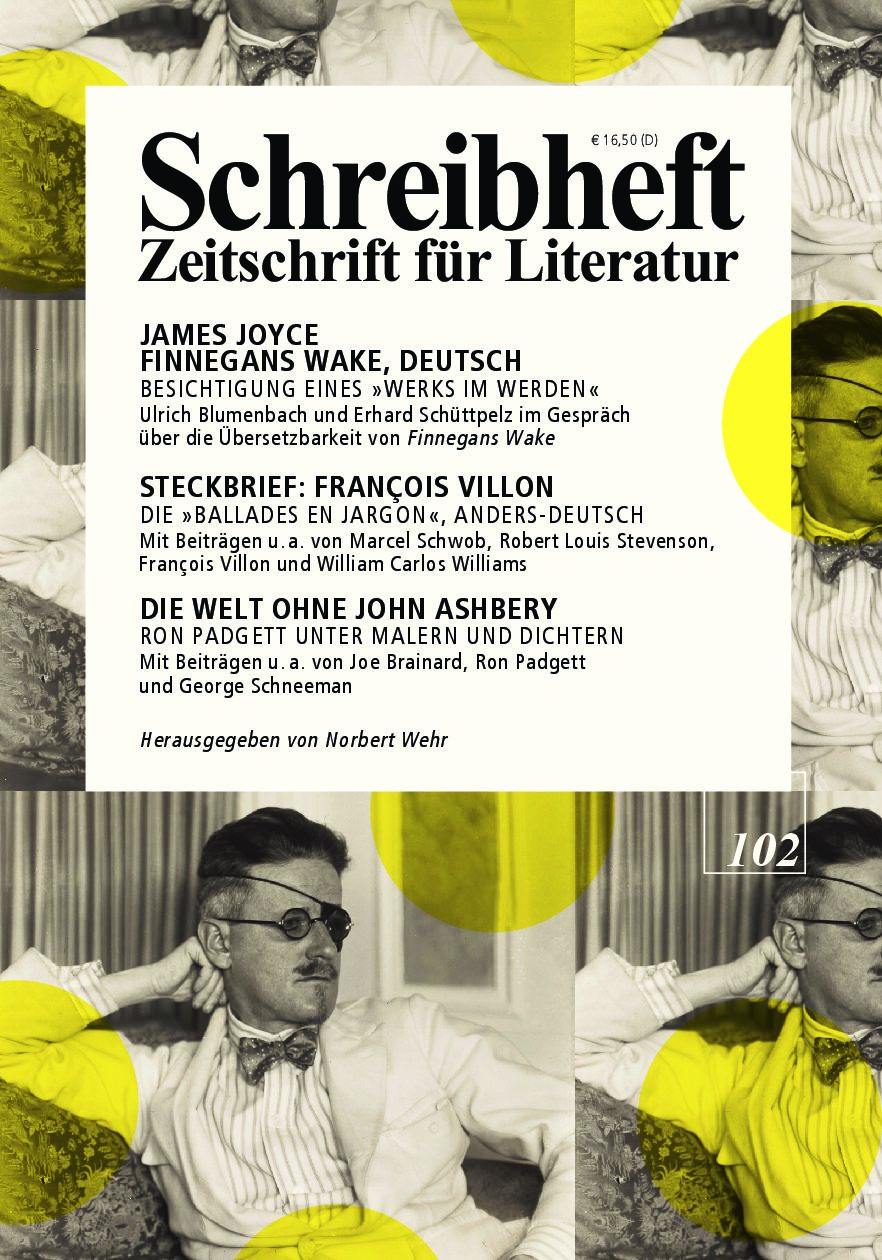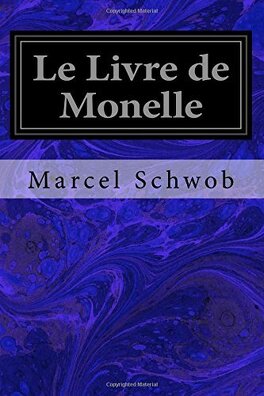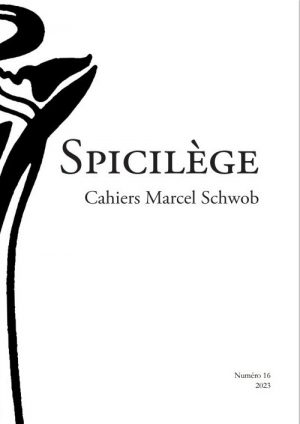Les Romans d’avant-garde à l’âge d’or
de la presse symboliste en France (1885-1905)
Université Paris Nanterre
29 février et 1er mars 2024
Bâtiment Ricoeur, Salle des conseils, 4e étage
Ce colloque constitue l’épilogue d’un programme de recherche international consacré à la réévaluation, sous un prisme analytique renouvelé, d’un corpus de romans avant-gardistes, souvent relégués à la périphérie du champ littéraire de la Belle Époque et principalement issus des mouvements Décadent et Symboliste.
Malgré la richesse des analyses consacrées aux romans décadents, le roman symboliste a longtemps été négligé par la critique littéraire jusqu’à l’aube du XXIe siècle. Cette lacune se manifeste notamment par la sous-représentation de ces œuvres dans le panorama des courants romanesques du XIXe siècle, attribuable en partie à la prédominance accordée au symbolisme en tant que mouvement poétique et à une approche essentiellement thématique des études littéraires antérieures.
L’originalité de ce programme de recherche réside dans l’examen des interactions entre les œuvres symbolistes et décadentes et le paysage médiatique de la fin du XIXe siècle, afin de mettre en exergue le rôle des collaborations et des institutions littéraires dans l’émergence de nouvelles formes. Une attention particulière sera accordée à la dernière décennie du siècle, période marquée par l’apparition de maisons d’édition avant-gardistes et par la création de collections artistiques au sein de revues telles que le Mercure de France et La Revue blanche, formant un véritable écosystème médiatique.
Le colloque est structuré autour de trois axes principaux: l’analyse du système socio-historique du roman d’avant-garde, l’évolution générique du roman symboliste, et l’étude des innovations formelles, stylistiques et narratives.
Programme
Jeudi 29 février
9h30: accueil
9h45: Introduction (Yosuké Goda et Julien Schuh)
10h-12h: Presse et édition
Julien Schuh (Université Paris Nanterre): Le marché des éditeurs d’avant-garde: Savine, Deman, Dentu et les autres
Yosuké Goda (Université de Yamagata): Les éditions du roman autour de la Revue indépendante
Yoan Vérilhac (Université de Nîmes): Les formats du récit en prose
13h30-15h: La critique romanesque
Helen Craske (Merton College, University of Oxford): Au-delà de la perversité : Rachilde, écrivain et critique de l’avant-garde
Jean-Louis Meunier : De René Doumic à Saint-Georges de Bouhélier : variations sur le roman
15h30-17h30: Figures et caractères I
Romain Enriquez (Cellf 19-21): L’Absente et La Passante d’Adrien Remacle
Christophe Longbois-Canil: Fénéon: un personnage de fiction
Alexia Kalantzis (Université Paris Cité, CERILAC): « Il n’y a, en littérature, qu’un sujet, celui qui écrit » : discours sur soi et expérimentation formelle dans les romans de Remy de Gourmont
Vendredi 1er mars
10h-12h: Figures et caractères II
Clément Dessy (FNRS, Université libre de Bruxelles): La traduction de romans à La Revue blanche
Guy Ducrey (Université de Strasbourg): Anna De Noailles romancière symboliste?
Les cas limites et inclassables. Table ronde:
Bruno Fabre (Président de la Société Marcel Schwob), “Marcel Schwob, Le Livre de Monelle”,
Franck Javourez, “Henri de Régnier, La Double Maîtresse”
et Evanghelia Stead (UVSQ Paris-Saclay), “Gabriel Mourey, L’Embarquement pour ailleurs”
13h30-15h30: Inventions génériques I
Vincent Gogibu (CHCSC, UVSQ Paris-Saclay): Il y a une volupté dans la douleur, le roman symboliste d’un poète : Joachim Gasquet
Adeline Heck (FNRS, Université libre de Bruxelles, Philixte et LaM): Les Lauriers sont coupés d’Édouard Dujardin et les origines musicales du monologue intérieur
Jessica Desclaux (FNRS, UClouvain) : Le Culte du Moi. Barrès ou de la résistance au genre du roman
16h-17h30: Inventions génériques II
Franck Javourez: Le Roman wagnérien
Sophie Lucet (Université Paris Cité): Le roman théâtral symboliste
Organisation
Yosuké Goda (Université de Yamagata) & Julien Schuh (Université Paris Nanterre)