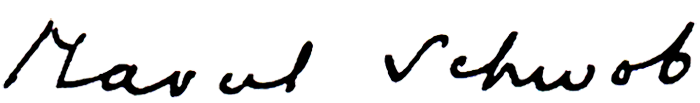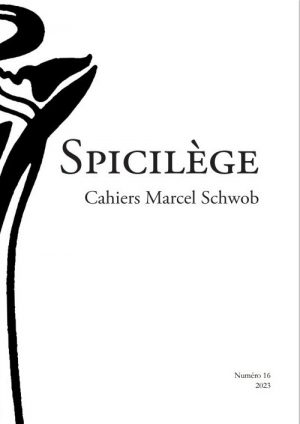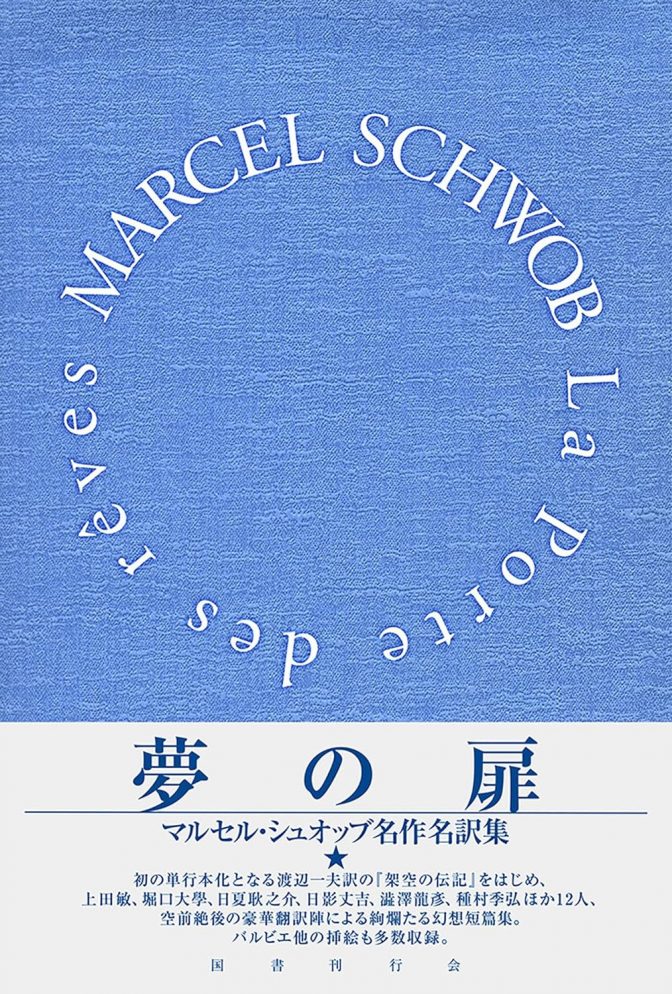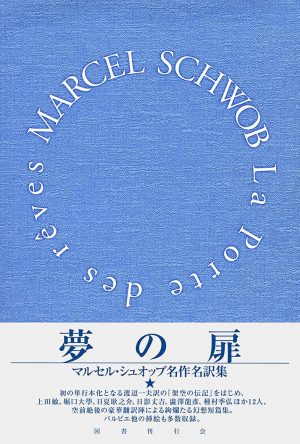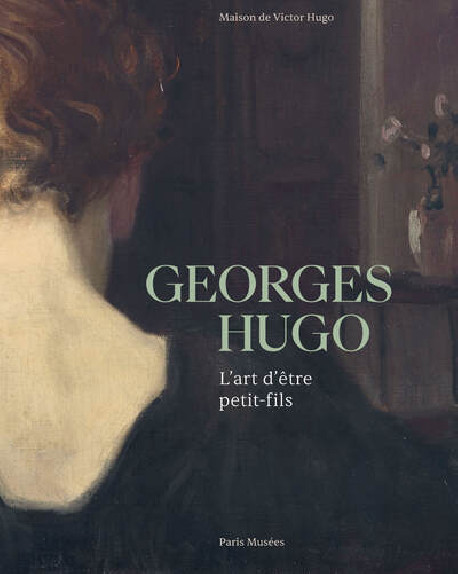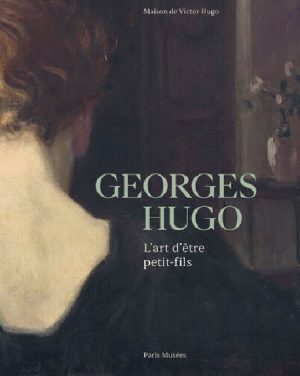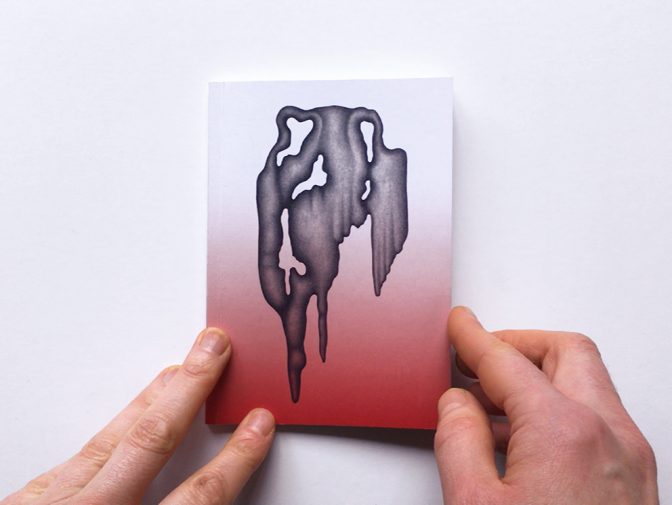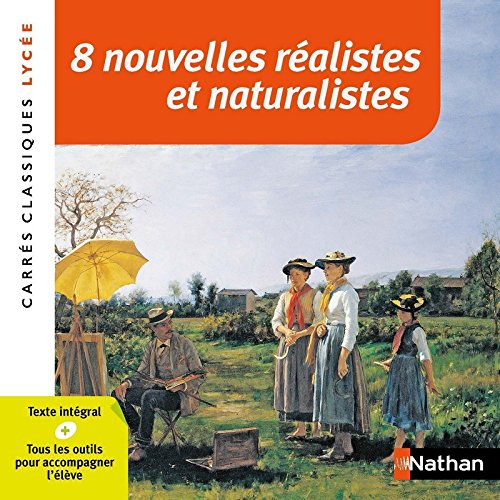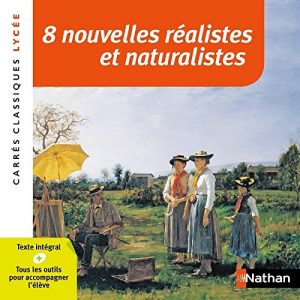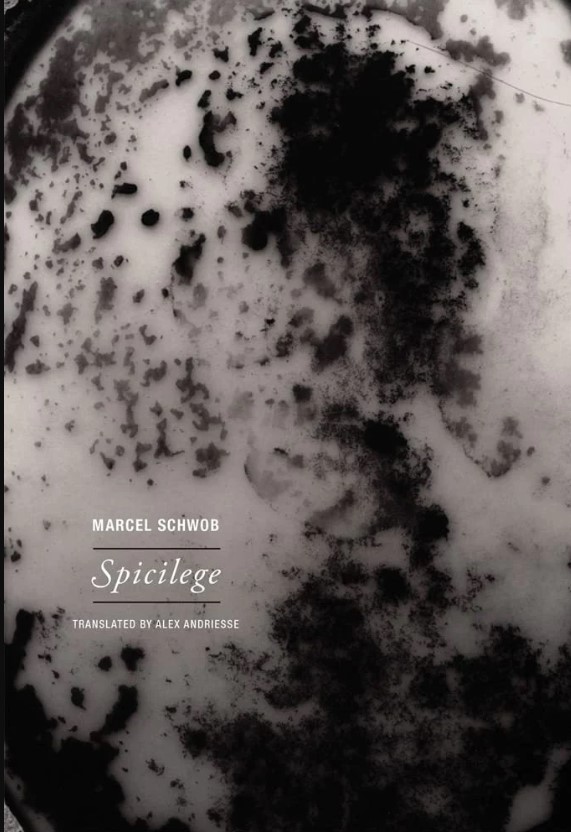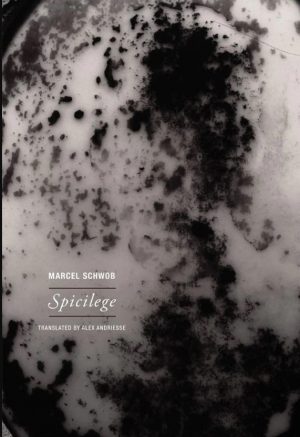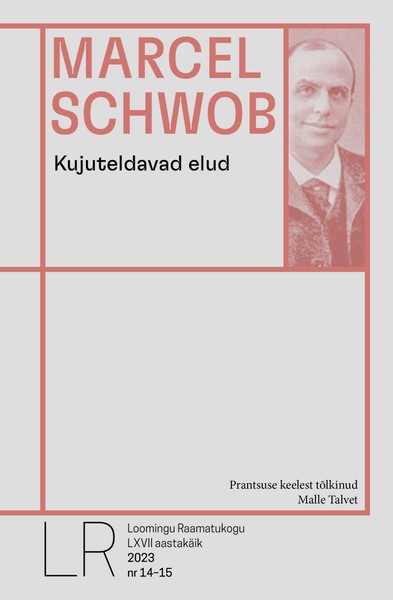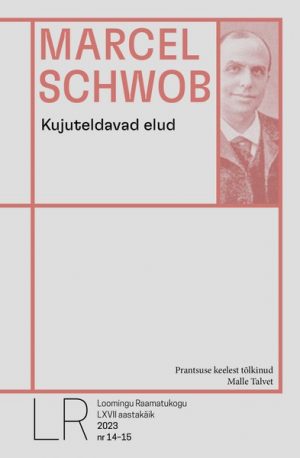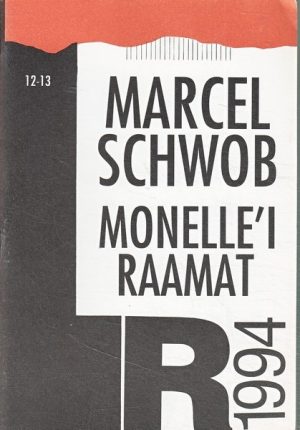SPICILÈGE – CAHIERS MARCEL SCHWOB n° 16 (2023)
(janvier 2024, 208 pages)
Direction : Bruno Fabre
Rédaction :
Bruno Fabre – Agnès Lhermitte
Jean-Louis Meunier
Prix : 15 euros
Les commandes sont à adresser à la Société Marcel Schwob :
societe.marcel.schwob@gmail.com
Éditorial
Bruno Fabre
Résonances de Vies imaginaires
aux XXe-XXIe siècles (première partie)
Pierre Veber, auteur de vies imaginaires
Bruno Fabre
Vies imaginaires de Marcel Schwob
et Songes perdus de Han Ryner
Agnès Lhermitte
Ritratti di ignoti e non de Piero Fornasetti :
une évocation de Vies imaginaires
Bruno Fabre
Lucio Del Pezzo et Marcel Schwob
Bruno Fabre
La Vie de Cyril Tourneur, imaginée
par Marcel Schwob, réalisée par Jean-Pierre Gras
Danièle Berton-Charrière
Olimpia de Cécile Minard : une fiction biographique
dans le sillage de Vies imaginaires
Bruno Fabre
Des « vies imaginaires » au musée :
Les Fantômes du Louvre d’Enki Bilal
Agnès Lhermitte
Patricia Farazzi, Michel Valensi :
Marcel Schwob, « fantôme bienveillant »
Agnès Lhermitte
Lettres du chemin de pierre (extraits)
Patricia Farazzi, Michel Valensi
Relire Schwob au XXIe siècle : le cas des Vite sognate
del Vasari d’Enzo Fileno Carabba
Giorgia Testa
Entretien avec Enzo Fileno Carabba
Textes retrouvés
Jean de Tinan, lecteur de Vies imaginaires
Bruno Fabre
- Marcel Schwob
Jean de Tinan
Trois articles critiques sur Vies imaginaires
Bruno Fabre
Critique littéraire (Le Journal, 13 juin 1896)
[sur Vies imaginaires et La Croisade des enfants]
Armand Silvestre
Vies imaginaires – Marcel Schwob
(Le Phare de la Loire, 18 juin 1896)
Léon Brunschvicg
Bibliographie (La Nouvelle Revue, sept-oct. 1896)
[sur Vies imaginaires]
Claudius Jacquet
Bibliographie
Bruno Fabre
Vies imaginaires en éditions séparées
Les traductions de Vies imaginaires
Traductions de Vies imaginaires
Traductions de Vies imaginaires en éditions séparées
Bibliographie en caractères japonais
Takeshi Matsumura
Glanures
Bruno Fabre, Agnès Lhermitte, Takeshi Matsumura
Hommage à Christian Berg
Agnès Lhermitte